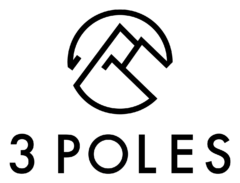Islande
« Veillez car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
Mathieu, 25, 13
JOURNAL DE BORD – ISLANDE
Ballade islandaise
Avant Propos
Ce récit relate des faits survenus sur le haut plateau islandais, entre le 2 et le 9 mars 2004, lors d’une tentative de traversée de l’Islande du nord au sud.
Cette expédition, à ski nordique et en autonomie complète, s’est conclue par l’organisation d’une opération de sauvetage, mobilisant plusieurs dizaines de personnes pendant plus de 50 heures.
Ces événements firent l’objet de divers reportages et comptes-rendus dans les principaux média islandais – radio, presse et télévision – tout au long des 3 jours que durèrent les opérations de recherche.
Les quelques pages qui suivent retracent le déroulement de cette ballade nordique, organisée avec le soutien logistique et les précieux conseils de Grand Nord Grand Large, et l’apprentissage que nous fîmes de cette terre d’Islande, pays terrible et merveilleux.
Direction Sud
| 1er Mars 2004 |
Température +5°c / +10°c
 Nous nous retrouvons avec Olivier vers 9 heures du matin pour embarquer l’ensemble du matériel : skis et peaux de phoque, pulkas, rations quotidiennes d’aliments secs ou lyophilisés, bottes Sorel, tente d’expé, GPS, cartes, boussoles, sacs de couchage, réchaud, équipement personnel, etc. Le tout pèse environ 100 kilos.
Nous nous retrouvons avec Olivier vers 9 heures du matin pour embarquer l’ensemble du matériel : skis et peaux de phoque, pulkas, rations quotidiennes d’aliments secs ou lyophilisés, bottes Sorel, tente d’expé, GPS, cartes, boussoles, sacs de couchage, réchaud, équipement personnel, etc. Le tout pèse environ 100 kilos.
Nous décollons de Roissy vers 13 heures et atterissons à Keflavik, l’aéroport international de Reykjavik, un peu avant 16 heures – heure locale. Sylvie, le contact que nous a indiqué GNGL, nous y attend pour nous conduire à Reykjavik, au terminal des vols nationaux.
Nous embarquons ensuite sur un vol d’une quarantaine de minutes, à destination d’Akureyri, le lieu de départ de notre traversée, situé sur la côte nord de l’Islande à la limite du cercle polaire arctique.
La température est étonnamment élevée. A Reykjavik, pas la moindre trace de neige. Depuis le hublot de notre avion, je scrute le plateau que nous devrons traverser plus à l’est dans quelques jours, en direction du sud. Quelques névés alternent avec d’immenses étendues grisâtres. On est venu pour la neige, on se retrouve avec de la boue. Tirer une pulka d’une quarantaine de kilos sur la glace ne demande pas un effort considérable. Sur de la terre ou des rochers, ca devient une autre histoire…
A Akureyri, nous sommes accueillis par Bjorn qui doit nous acheminer le lendemain au départ de la traversée. Il nous conduit à l’auberge de jeunesse où nous passerons la nuit. La neige est désespérément absente. Espérons, que demain, là-haut sur le plateau…
| 2 Mars 2004 |
Température +4°c / +7°c
 Bjorn nous retrouve à 9 heures à l’auberge de jeunesse. Nous nous sommes levés 2 heures plus tôt pour vérifier le matériel et préparer les pulkas. Nous hissons tout notre équipement à bord de la Super Jeep de Bjorn, un véhicule impressionnant dont le châssis m’arrive au niveau de la taille et dont les roues ont la largeur de celles d’un tracteur. Une voiture à l’islandaise. Aussi démente que ce pays. 40 litres au 100 km, et encore en terrain favorable, m’indique Bjorn avec un grand sourire. Ca ne va pas fait plaisir à tout le monde…
Bjorn nous retrouve à 9 heures à l’auberge de jeunesse. Nous nous sommes levés 2 heures plus tôt pour vérifier le matériel et préparer les pulkas. Nous hissons tout notre équipement à bord de la Super Jeep de Bjorn, un véhicule impressionnant dont le châssis m’arrive au niveau de la taille et dont les roues ont la largeur de celles d’un tracteur. Une voiture à l’islandaise. Aussi démente que ce pays. 40 litres au 100 km, et encore en terrain favorable, m’indique Bjorn avec un grand sourire. Ca ne va pas fait plaisir à tout le monde…
Détour par la station-service pour remplir notre bidon d’essence, puis récupération du téléphone NMT qui sera notre unique lien avec l’extérieur en cas de problème, avant de prendre la route, plein sud, vers le haut du plateau islandais au fond du fjord d’Akureyri.
La route s’enfonce entre les montagnes qui surplombent le fjord. Quelques fermes isolées, de plus en plus rares à mesure que nous nous éloignons d’Akureyri, sont posées au milieu d’un paysage de terre grise, de cailloux et d’herbe jaune. L’Islande, la vraie, mais l’Islande en été ! Au moins, nous n’avons pas à parcourir, à pied, en portant tout notre équipement, les 40 kilomètres qui nous séparent de la fin du fjord. Cher Bjorn ! J’espère bien qu’il va nous remonter jusqu’en haut du plateau, là où les sommets, couverts de neige, qui nous dominent, semblent indiquer des conditions plus favorables à la réalisation de notre traversée.
Malheureusement, Bjorn ne semble pas avoir des ambitions démesurées pour aujourd’hui. Et surtout pas la moindre envie d’abîmer la belle mécanique de son monstre sur roues. Il s’arrête tout d’un coup, en plein milieu de la campagne, nous assure qu’il ne peut aller plus loin et nous indique un sommet sur le côté droit du fjord, 700 mètres plus haut.
– Le plateau est là-haut. Là-haut vous aurez de la neige.
– C’est bien gentil, mais on monte comment ?
– Faut porter.
Les Islandais rigolent parfois. Mais là, non. Il voulait vraiment qu’on trimballe nos 100 kilos de barda – pulkas et skis compris – à dos d’homme, sur 700 mètres de dénivelé. Sacrée première journée. Moi qui nous voyait déjà en train de skier tranquillement sur une bonne neige dure, avant la fin de l’après-midi.
Bjorn nous salue et nous souhaite bonne chance.
– S’il y a un problème, vous avez mon numéro ?
– Oui, oui,…
J’ai l’impression qu’il est sûr qu’on le rappellera dans quelques heures, quelques jours tout au plus, lassés de cette température si clémente, de ces conditions de terrain si pourries ; que le camping dans la boue et les portages à répétition auront vite raison de notre belle motivation. J’aime bien sa bonne bouille de bûcheron du nord, mais quand je vois la masse de matériel à mes pieds, il faut bien l’avouer, il commence à m’énerver.
Avec Olivier, j’entame la répartition des charges. Pour chaque pulka et son contenu, il faudra faire deux trajets, avec à chaque fois un peu plus de 25 kilos sur le dos. Deux montées et une descente. 2 100 mètres de dénivelé cumulé dans la journée avec des Sorel Grand Froid aux pieds, totalement inadaptées à ce type d’exercice et de température, et des pulkas qu’il faut porter, hisser, tirer.
L’arrivée au sommet est splendide. Le ciel s’est un peu dégagé et la vue sur la vallée en contrebas est magnifique. Même si la température reste élevée, l’ambiance est déjà un peu plus nordique. Le sol est recouvert de neige et un vent constant souffle à 45 km/h de moyenne. La tente est rapidement montée dans les rafales. Nous y sommes ! Enfin ! Un premier bivouac de rêve avec une vue plongeante sur la civilisation que nous allons abandonner demain, pour une douzaine de jours. Plus de 250 kilomètres au milieu de nulle part, pour effectuer la traversée d’un immense désert blanc. Je prépare le dîner pendant qu’Olivier s’est assoupi. Extinction des feux à 21 heures pour un repos bien mérité.
| 3 Mars 2004 |
Température -6°c / +1°c
 Le temps ne s’est pas amélioré pendant la nuit. Le vent est fort et charrie une neige épaisse, apportée par des nuages gris qui bouchent l’horizon. Au fur et à mesure que nous avançons, nous pénétrons dans la couche de nuages. Une sorte de brouillard nous entoure désormais. On n’y voit rien.
Le temps ne s’est pas amélioré pendant la nuit. Le vent est fort et charrie une neige épaisse, apportée par des nuages gris qui bouchent l’horizon. Au fur et à mesure que nous avançons, nous pénétrons dans la couche de nuages. Une sorte de brouillard nous entoure désormais. On n’y voit rien.
La progression est lente et la route difficile à trouver. Plein sud, bien sûr, mais nous sommes encore à la lisière du fjord sur un relief tourmenté. A gauche, un peu en arrière, je devine les contreforts des montagnes, au sommet desquelles nous progressons, dont le flanc pour certaines est passablement escarpé. Légèrement sur la droite, la pente devient plus prononcée et mène à un sommet que je devine à peine. Il faut donc essayer d’avancer en évitant des montées et descentes inutiles et surtout fatiguantes avec une pulka qui, dans le moindre dévers verse et se retourne.
Nous consultons souvent la carte afin de contourner les obstacles et d’éviter les pentes trop fortes dans lesquelles notre pulka nous entraînerait. Les contreforts du fjord ne semblent pas en finir. Nous savons que nous progressons trop lentement par rapport à notre plan de marche.
Au bout d’une demi-heure, je casse la fixation de mon ski gauche. Je réparerai plus tard. Pour l’instant, nous espérons tous les deux entrer définitivement sur le plateau. Les skis fixés sur ma pulka, j’avance en enfonçant dans la poudreuse ou en glissant sur les faibles pentes glacées. Sans skis et sans peaux de phoque, c’est une véritable galère. A mesure que la journée avance, la neige qui tombe toujours devient de plus en plus collante et mouillée. Elle trempe nos gore-tex. Je sens l’humidité qui colle à mes vêtements et je commence à avoir froid.
Vers 14h30, la visibilité est quasi nulle. Je propose à Olivier de nous arrêter et de monter le camp. Sale journée. On ne rêve, tous les deux, qu’à une seule chose : -20°c, du soleil, pas de vent. C’est trop demander ?.
| 4 Mars 2004 |
Température -10°c / -1°c
 Le réveil est poussif. Le vent s’est calmé, mais le brouillard est toujours aussi épais. Dès les premières minutes de ski, ma fixation, réparée hâtivement la veille au soir, casse à nouveau. Je suis fou de rage. Je me vois mal effectuer les 250 kilomètres qu’il nous reste encore à parcourir à pied ou sur un ski. Après quelques tentatives de réparation infructueuse, je décide de passer une nouvelle journée à pied. Olivier, à skis, impose le rythme à notre petit groupe ; je m’enfonce de plusieurs centimètres à chaque pas, mais il nous faut absolument progresser rapidement. Notre première journée consacrée à la grimpette s’est soldée par un zéro pointé sur le tableau des distances. Hier, nous n’avons progressé que de 7 kilomètres. La journée de marge que nous nous étions accordés est désormais perdue. Il nous faut avancer, et vite, afin de respecter au plus près notre tableau de marche.
Le réveil est poussif. Le vent s’est calmé, mais le brouillard est toujours aussi épais. Dès les premières minutes de ski, ma fixation, réparée hâtivement la veille au soir, casse à nouveau. Je suis fou de rage. Je me vois mal effectuer les 250 kilomètres qu’il nous reste encore à parcourir à pied ou sur un ski. Après quelques tentatives de réparation infructueuse, je décide de passer une nouvelle journée à pied. Olivier, à skis, impose le rythme à notre petit groupe ; je m’enfonce de plusieurs centimètres à chaque pas, mais il nous faut absolument progresser rapidement. Notre première journée consacrée à la grimpette s’est soldée par un zéro pointé sur le tableau des distances. Hier, nous n’avons progressé que de 7 kilomètres. La journée de marge que nous nous étions accordés est désormais perdue. Il nous faut avancer, et vite, afin de respecter au plus près notre tableau de marche.
En début d’après-midi, le temps s’améliore enfin. Le vent est faible, le soleil pointe de temps en temps à l’horizon. La neige collante et humide a laissé place à un air frais et sec. Par moments, c’est un véritable bonheur.
Le camp est dressé vers 18 heures. Nous retrouvons petit à petit les automatismes caractéristiques de ce type d’équipée : décharger les pulkas, monter la tente, organiser un minimum de confort dans cet espace confiné encombré par les tapis de sol, nos sacs de couchage, les vêtements qui sèchent, les lampes frontales qu’on cherche à tâtons dans l’obscurité, les sachets d’aliments, les paires de chaussettes, les gants ou les sous-gants. La vie dans notre réduit s’organise tranquillement. Je fais le point sur le GPS et les cartes. Olivier surveille la flamme du réchaud qui émet, à l’allumage, un ronronnement apaisant, puis au bout de quelques secondes, un sifflement rauque propageant immédiatement une douce chaleur à l’intérieur de la tente. Le dîner est préparé, les Thermos remplies d’eau bouillante qui sera réchauffée le lendemain matin pour le petit déjeuner. On resserre les bandes d’Elastoplast qui doivent prévenir l’arrivée des ampoules.
Je répare une nouvelle et dernière fois – du moins je l’espère – ma fixation : vissage, dévissage, une large bande autocollante censée résister aux basses températures et, surtout, à l’humidité. Puis, j’inaugure l’atelier couture. Il faut recoudre mon sous-gant en Néoprène dont l’index et le majeur menacent de partir en lambeau.
Quand je sors de la tente vers 22 heures, la pleine lune éclaire un paysage magnifique. Une fine couche de neige encore vierge recouvre le sol gelé. Le ciel est dégagé. Tout est calme. Les étoiles étincellent et une lumière diffuse recouvre l’immensité blanche du plateau islandais. J’écoute le bruit du silence. Magique.
La débâcle
| 5 Mars 2004 |
Température -11°c / -6°c
 Lever vers 7 heures, puis départ à 9 heures pour une grosse journée. Il nous faut rattraper le retard accumulé au cours des deux premiers jours.
Lever vers 7 heures, puis départ à 9 heures pour une grosse journée. Il nous faut rattraper le retard accumulé au cours des deux premiers jours.
C’est un nouveau jour blanc. On ne voit rien au-delà de quelques mètres. Impossible de distinguer le relief. Une sensation vraiment étrange… Pendant toute la matinée, j’ai l’impression de tourner complètement en rond. A l’approche de midi, le ciel s’éclaircit.
Quelques très belles lumières dessinent un paysage irréel. Nous découvrons, nous encerclant à l’est et à l’ouest, les deux immenses glaciers qui nous serviront de point de repère pendant toute la traversée du haut plateau.
La dernière heure de ski aura été inutile : nous sommes bloqués par une rivière dégelée. A cette époque de l’année, et compte tenu de l’importance des cours d’eau islandais dans lesquels se déversent en été le trop plein des masses glaciaires du centre de l’Islande, cette situation totalement imprévue nous inquiète. Si un dégel – même ponctuel – a commencé ici dans le nord, le terrain plus au sud, où les cours d’eau sont les plus nombreux et les plus larges, risque d’être impraticable. Il faut absolument que la température baisse rapidement et de manière significative.
Impossible de franchir la rivière à cet endroit. Nous passons en revue les solutions envisageables : remonter le cours de la rivière afin de trouver un pont de neige, passer la rivière à gué à un endroit peu profond, traverser sur la pulka en l’utilisant comme une embarcation. Compte tenu de la force du courant, cette dernière solution ne m’enthousiasme guère. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que c’est le meilleur moyen de se planter royalement ! A 17h30, notre décision est prise : si dans 20 minutes, nous n’avons pas trouvé un passage en amont, nous franchirons la rivière à gué. Ca ne nous enchante pas : nous sommes assurés de traîner pendant tout le reste de notre traversée des Sorel trempées et gelées. Le meilleur moyen d’abandonner, surtout si la température venait à chuter rapidement.
Le passage se fait finalement sans encombre, quelques centaines de mètres plus haut, sur un pont de neige encore suffisamment solide pour porter notre poids et celui des pulkas. Mais nous avons perdu une heure et le retard n’est toujours pas rattrapé. Skogar est encore loin, il va falloir pousser.
| 6 Mars 2004 |
Température -12°c / -6°c
 Ce matin, il fait un temps superbe. Pour la première fois depuis le début de la semaine, il n’y a pas un nuage, pas un souffle de vent. Nous en profitons pour sécher une partie de notre équipement au soleil.
Ce matin, il fait un temps superbe. Pour la première fois depuis le début de la semaine, il n’y a pas un nuage, pas un souffle de vent. Nous en profitons pour sécher une partie de notre équipement au soleil.
Comme tous les matins, le départ est donné vers 9 heures. Le rythme de progression est bon. Le ski est fabuleux : la neige est dure, les paysages superbes. Après ces premiers jours de mauvais temps, c’est un vrai bonheur. Nous sommes seuls, loin de tout, pas une trace, pas le moindre signe de vie. Une immensité désertique. Ce sont des moments uniques.
Le temps se couvre à nouveau légèrement en début d’après-midi. Notre progression, plein sud, est bloquée par une nouvelle rivière en eau qui coule nord-est, sud-ouest. Nous décidons de la longer afin de trouver, comme la veille, un point de passage encore praticable. Il n’est plus question de remonter le cours vers le nord. Nous ne pouvons pas perdre tous les jours des heures précieuses en effaçant l’après-midi une partie du terrain gagné le matin même. Mais plus nous avançons vers l’aval, plus elle nous emporte à l’ouest vers le glacier Hofsjokull, nous déviant ainsi de notre route.
A mesure que nous progressons, la rivière grossit et s’encaisse, gonflée par de nouveaux petits affluents. En milieu d’après-midi, nous sommes bloqués par un nouvel affluent qui coule cette fois du nord-ouest au sud-est. Nous sommes pris en tenaille par le cours principal à notre gauche et son affluent sur la droite. Ce n’est plus de l’orientation. Ca devient de plus en plus un jeu d’évitement, de fuite, loin de ces obstacles naturels, qui n’ont rien de très « naturel » à cette époque de l’année. Comment expliquer qu’il y ait déjà autant d’eau début mars ? Nous devons être parmi les premiers à réaliser la traversée nord-sud cette année. Que découvriront les éventuelles équipes suivantes ? Mais je sais que cette question n’a pas de sens en Islande. Dans quelques jours, quelques semaines tout au plus, les températures chuteront, le vent du sud tombera et la région reculée que nous traversons sera à nouveau enserrée dans une gangue de glace qui pourra se maintenir jusqu’à l’été. Pour l’heure, ces conditions combinées au manque de neige – nos pulkas et nos peaux de phoque sont régulièrement rabotées par des rochers ou de la lave qui affleurent à la surface du manteau neigeux – rendent la traversée de plus en plus aléatoire.
 Il nous faut sortir de cette impasse. La rivière principale me semble trop large, trop profonde et le courant trop fort. Nous optons pour son affluent. Après quelques hésitations – comment traverser ce bras d’eau sans tremper irrémédiablement tout notre équipement – nous décidons de retirer nos Sorel, de relever nos jambes de pantalon au maximum et de traverser pieds nus le cours d’eau en tirant nos pulkas qui devraient plus ou moins flotter. Cette histoire de cours d’eau nous emmerde, mais la situation nous fait assez rire. Je passe le premier. L’eau est glaciale, le fond inégal, le courant modéré, mais assez fort pour embarquer immédiatement ma pulka vers l’aval de la rivière. J’ai de l’eau au niveau des genoux, la pulka manque de se renverser. Je prends pied sur la rive opposée. Le contact de la neige et de l’air froid est piquant. Je hisse ma pulka sur la rive, me dépêche d’en sortir une paire de chaussettes chaudes en laine polaire, me sèche les pieds et les jambes avant de remettre mes Sorel. C’est au tour d’Olivier. Nous sommes tous les deux au sec. Mais la perte de temps est considérable et condamne notre équipée si nous devons répéter cette opération plusieurs fois par jour.
Il nous faut sortir de cette impasse. La rivière principale me semble trop large, trop profonde et le courant trop fort. Nous optons pour son affluent. Après quelques hésitations – comment traverser ce bras d’eau sans tremper irrémédiablement tout notre équipement – nous décidons de retirer nos Sorel, de relever nos jambes de pantalon au maximum et de traverser pieds nus le cours d’eau en tirant nos pulkas qui devraient plus ou moins flotter. Cette histoire de cours d’eau nous emmerde, mais la situation nous fait assez rire. Je passe le premier. L’eau est glaciale, le fond inégal, le courant modéré, mais assez fort pour embarquer immédiatement ma pulka vers l’aval de la rivière. J’ai de l’eau au niveau des genoux, la pulka manque de se renverser. Je prends pied sur la rive opposée. Le contact de la neige et de l’air froid est piquant. Je hisse ma pulka sur la rive, me dépêche d’en sortir une paire de chaussettes chaudes en laine polaire, me sèche les pieds et les jambes avant de remettre mes Sorel. C’est au tour d’Olivier. Nous sommes tous les deux au sec. Mais la perte de temps est considérable et condamne notre équipée si nous devons répéter cette opération plusieurs fois par jour.
A 18h30, le jour commence à décliner, mais nous décidons de faire une session de deux heures supplémentaires afin de rattraper le retard perdu. Plus au sud, à quelques kilomètres s’étend un lac partiellement gelé et sur notre gauche, une immense étendue de blocs de glace de taille variable, posés sur le fonds de la rivière principale que nous longeons depuis plusieurs heures. Désolidarisés les uns des autres par la débâcle précoce, ils forment un champ resserré d’immenses champignons blancs. L’eau coule librement au pied de ces gros glaçons que le dégel aura bientôt fait totalement disparaître. Nous devons être face à une sorte d’estuaire qui se déverse en été dans le lac que nous apercevons plus loin. C’est l’occasion d’essayer de franchir enfin cette rivière qui barre notre progression vers le sud.
A la tombée du jour, nous nous engageons sur ces ponts de glace instables. Nous progressons d’un bloc à l’autre, parfois séparés d’un bon mètre, et surplombant la rivière en contrebas de plusieurs mètres. Le paysage est irréel. Le chaos de glace succède au chaos sur une distance énorme.
 La nuit est tombée. Alors que nous pensons avoir atteint l’autre rive de l’estuaire, nous tombons sur un passage infranchissable. Ici, la rivière a du emporter depuis longtemps les blocs de glace qui nous ont servi de ponton. L’eau coule librement. Son cours, encore plus large et encaissé, est bordé de deux murs de glace lisse de plusieurs mètres de haut. Il est impensable de passer. Une dizaine de mètres nous séparent de l’autre rive. Et pour atteindre le côté opposé, il faudrait descendre puis remonter ces murs naturels, dont la hauteur varie de 3 à 6 mètres, plongeant directement dans l’eau glacée. Je suis abasourdi. La nuit tombée et la clarté blafarde de la lune ajoutent une touche irréelle à notre sentiment d’impuissance et à l’anormalité des conditions que nous rencontrons. Il est trop tard pour faire demi-tour. Refaire le chemin parcouru en sens inverse, en pleine nuit, comporterait trop de risques.
La nuit est tombée. Alors que nous pensons avoir atteint l’autre rive de l’estuaire, nous tombons sur un passage infranchissable. Ici, la rivière a du emporter depuis longtemps les blocs de glace qui nous ont servi de ponton. L’eau coule librement. Son cours, encore plus large et encaissé, est bordé de deux murs de glace lisse de plusieurs mètres de haut. Il est impensable de passer. Une dizaine de mètres nous séparent de l’autre rive. Et pour atteindre le côté opposé, il faudrait descendre puis remonter ces murs naturels, dont la hauteur varie de 3 à 6 mètres, plongeant directement dans l’eau glacée. Je suis abasourdi. La nuit tombée et la clarté blafarde de la lune ajoutent une touche irréelle à notre sentiment d’impuissance et à l’anormalité des conditions que nous rencontrons. Il est trop tard pour faire demi-tour. Refaire le chemin parcouru en sens inverse, en pleine nuit, comporterait trop de risques.
Nous sommes partis depuis plus de 11 heures. Nous sommes bloqués au beau milieu d’un immense chaos glaciaire de 700 à 800 mètres de large. Bien entendu, il est hors de question de planter la tente dans cette zone. A distance respectable de la bordure des murs de glace dont des pans menacent d’être emportés par le violent courant, nous progressons, à la lampe frontale, le long de la rivière. Dans cette immensité, nous parvenons à mettre pied sur un bras de terre au centre de l’estuaire. La couche de neige est mince et le sol rocheux. La tente est plantée à 21h30.
Un point sur notre position à l’aide du GPS. Il nous faut prendre une décision. Même si nous parvenions à franchir cette impressionnante rivière, les difficultés liées à la débâcle iront en s’accroissant à mesure que nous descendrons vers le sud. Les journées à venir risquent d’être consacrées, pour l’essentiel, à la recherche d’une succession de ponts de neige, avec tous les risques que leur passage comporte en cette période de réchauffement marqué. En observant sur la carte la densité du réseau hydraulique plus au sud, nous sommes désormais persuadés qu’il sera impossible d’atteindre le Landmannalaugar – le point de récupération le plus au nord qui avait été envisagé dès notre départ en cas de dégel précoce – encore moins notre objectif initial, la ville de Skogar sur la côte sud. Si nous sommes bloqués avant d’arriver au Landmannalaugar les frais de récupération, en superjeep et motoneige, déjà élevés sur cette zone, vont atteindre des sommes astronomiques.
Notre décision est rapidement prise. Demain, nous remonterons la rivière pendant une heure pour essayer de trouver un passage hypothétique. Si aucune possibilité ne se présente, malgré toutes les promesses que nous nous sommes faites d’aller jusqu’au bout et de ne pas revenir sur nos pas, nous ferons demi-tour et remonterons plein nord. Je suis profondément déçu. Je connais déjà l’issue. Certainement, une décision sage… Une décision à la con.
La tempête
| 7 Mars 2004 |
Température 0 °c / +4°c
 Un vent fort souffle ce matin. Toujours ce vent du sud, chaud, humide, qui dégrade le paysage, depuis quelques jours, à une vitesse hallucinante. Le temps est couvert. L’heure fatidique est passée. Nous retournons à Akureyri. Plein nord.
Un vent fort souffle ce matin. Toujours ce vent du sud, chaud, humide, qui dégrade le paysage, depuis quelques jours, à une vitesse hallucinante. Le temps est couvert. L’heure fatidique est passée. Nous retournons à Akureyri. Plein nord.
Ce retour s’annonce tranquille. Notre arrivée à Skogar était prévue le 12 mars. Nous avons donc 5 à 6 jours devant nous pour parcourir les 80 kilomètres qui nous séparent de notre point de départ : 20 kilomètres par jour et une à deux journées de repos sur le chemin du retour pour goûter le paysage islandais et profiter éventuellement de conditions météo plus favorables.
La visibilité s’amenuise rapidement. C’est le début d’un nouveau jour blanc. On ne distingue plus les reliefs. On ne parvient plus à évaluer correctement les distances. Mais, désormais, le vent du sud nous pousse dans le dos et nous aide dans notre progression. Sa force s’accroît à mesure que les heures passent. Nous goûtons la situation : il suffit d’étendre les bras en croix et la portance devient suffisante pour nous entraîner, avec nos pulkas, à la vitesse d’un bon marcheur. Je prends des mesures à l’aide de mon anémomètre : 60, 70 puis 80 kilomètres à l’heure en moyenne.
En l’absence de toute notion de relief, nous perdons rapidement nos repères. J’ai l’impression de descendre une pente pendant plus d’une demi-heure. Je regarde mon altimètre : nous avons perdu à peine 6 mètres, autant dire rien. Sous l’effet combiné de l’absence de visibilité due au jours blanc et du vent qui nous entraîne, le plateau sur lequel nous progressons nous est tout à coup apparu comme une descente sans fin. Une déclivité d’autant plus incongrue que le plateau islandais est assez plat et que, si pente il y a, elle est globalement plutôt orientée dans un sens nord-sud.
Afin de couper au plus court, nous avons maintenant atteint les pentes d’un promontoire qui domine le paysage alentour. Les vents ne faiblissent pas. Il devient difficile de tenir debout. C’est un vent soutenu, sans répit. Il doit maintenant atteindre une centaine de kilomètres à l’heure en moyenne. Soudain, je vois la pulka d’Olivier – une dizaine de mètres devant moi – littéralement décoller à plus de 2 mètres au-dessus du sol. Elle tournoie deux fois sur elle-même et se rabat violemment, entraînant Olivier qui chute lourdement. J’ai du mal à y croire. Plus de 40 kilos de matériel soulevés dans les airs comme un fétu de paille ! Je vois Olivier se relever, faire quelques mètres, redresser sa pulka, puis à nouveau celle-ci est projetée, au-dessus de sa tête, par une rafale plus forte que les autres. Lorsque la longe qui relie sa pulka à son harnais ventral se tend, Olivier est une nouvelle fois projeté en avant.
Je n’ai pas bougé. Je suis impressionné par la force des éléments naturels. Je sens le danger. Je devine l’excitation qui envahit mon corps et l’euphorie qui me gagne, telle un sentiment de puissance incontrôlée. J’éclate de rire. Je sens que je suis dans l’action, confronté à l’Arctique, à ce qu’il a d’extrême.
J’avance. Je ne me rends d’autant moins compte de ce qui se passe que ma pulka – peut-être plus lourde ou mieux équilibrée – ne s’est pas envolée. Olivier s’est allongé à terre dans la pente à côte de sa pulka. Il ne bouge plus. A genoux dans la neige à quelques mètres de lui, je sors mon anémomètre pour ce qui sera ma dernière mesure : 119 km/h en moyenne. C’est fou ! Certaines rafales doivent atteindre 20 à 30 km/h de plus. Je me relève difficilement, dépasse Olivier, un peu plus haut dans la pente par rapport à moi. Je ne le regarde pas. Je ne me retourne pas. Ma pulka s’envole à son tour, me passe par-dessus. Je retombe lourdement. Un de mes bâtons m’enfonce les cotes. Je redresse la pulka. J’ai à peine fait 2 mètres quand elle s’envole à nouveau.
Je souhaite atteindre la crête qui délimite le sommet du monticule sur lequel nous nous trouvons afin de redescendre sur le versant opposé et m’abriter du vent. Mais, en l’atteignant, je risque d’être emporté par le vent sur le versant opposé dont le relief et la pente peuvent présenter des difficultés inattendues. Surtout, je risque de perdre Olivier. Sans visibilité, dans cette tempête invraisemblable, ce serait catastrophique. Comment se retrouver, où chercher ? Quelques dizaines de mètres nous séparent déjà, un dévers nous cache l’un à l’autre, le vent couvre nos voix. Il est impossible de communiquer. Chacun conserve une partie du matériel collectif : Olivier la tente et le réchaud, moi le pétrole, les instruments d’orientation (GPS, cartes,…) et le téléphone NMT.
Le bruit est hallucinant. Ma capuche me claque dans les oreilles. Le vent souffle, hurle. Il faut qu’Olivier me rejoigne. Allongé sur ma pulka, l’attente me paraît interminable. Qu’est-ce qu’il fout ?
Tout à coup, je le sens dans mon dos. Sa pulka vient heurter légèrement la mienne. Il nous faut dégager au plus vite. Descendre cette pente jusqu’au bas du promontoire sur lequel nous nous sommes engagés. 200 mètres. 300 mètres tout au plus. Mais qui nous paraissent une éternité. Nous progressons lentement dans la pente, couchés sur nos pulkas.
La pluie s’abat sur nous. Une averse de neige mouillée que le vent transforme en un véritable mur d’eau. Que faire ? Attendre ? Le vent n’a pas cessé d’enfler depuis le début de la matinée. Les conditions peuvent continuer à s’aggraver. Nous serons totalement trempés dans quelques minutes. Monter la tente ? Au risque de la voir s’envoler ou se déchirer et de perdre le seul abri dont nous disposons ?
 Rapidement, une décision est prise. Nous allons monter la tente. Avec précaution, lentement, nous extrayons de la pulka d’Olivier la toile principale et les piquets. En même temps qu’Olivier la déroule, je l’enfile comme un pull-over. Je sens la puissance du vent qui veut arracher la toile. Je me plaque contre le sol. J’essaye d’atteindre le fond de la tente. Tout claque autour de moi avec une violence hallucinante. La toile détrempée est plaquée contre mon visage. Je ne vois rien. J’étends mes bras et jambes. Les deux pulkas, à l’extérieur, sont reliées à mon harnais. J’entends Olivier, dehors, qui tente de maintenir les extrémités de la toile avec nos skis plantés dans le sens du vent, quasiment à l’horizontale, pour offrir le moins de portance possible. Il installe ensuite, une par une, les trois armatures de toit. Des minutes interminables s’écoulent. Le tunnel de la tente est déformé. Celle-ci dont l’espace intérieur est déjà faible offre un volume habitable réduit de moitié : 80 centimètres de large sur 60 centimètres de haut à une extrémité, 1 mètre 20 de large sur à peine 1 mètre de haut à l’autre.
Rapidement, une décision est prise. Nous allons monter la tente. Avec précaution, lentement, nous extrayons de la pulka d’Olivier la toile principale et les piquets. En même temps qu’Olivier la déroule, je l’enfile comme un pull-over. Je sens la puissance du vent qui veut arracher la toile. Je me plaque contre le sol. J’essaye d’atteindre le fond de la tente. Tout claque autour de moi avec une violence hallucinante. La toile détrempée est plaquée contre mon visage. Je ne vois rien. J’étends mes bras et jambes. Les deux pulkas, à l’extérieur, sont reliées à mon harnais. J’entends Olivier, dehors, qui tente de maintenir les extrémités de la toile avec nos skis plantés dans le sens du vent, quasiment à l’horizontale, pour offrir le moins de portance possible. Il installe ensuite, une par une, les trois armatures de toit. Des minutes interminables s’écoulent. Le tunnel de la tente est déformé. Celle-ci dont l’espace intérieur est déjà faible offre un volume habitable réduit de moitié : 80 centimètres de large sur 60 centimètres de haut à une extrémité, 1 mètre 20 de large sur à peine 1 mètre de haut à l’autre.
Olivier m’a rejoint à l’intérieur de la tente. Nous faisons pression sur le fond et le côté droit au vent pour soutenir les armatures qui plient. Le dos, les pieds collés à la paroi, nous tentons de soutenir la pression du vent afin de soulager la faible structure. Le double toit n’est toujours pas monté et l’eau dégouline à l’intérieur de notre abri. Après avoir malheureusement attendu beaucoup trop longtemps, je laisse Olivier à l’intérieur et sors pour installer le double toit. La neige fondue et l’eau de pluie accumulées à l’intérieur de la tente ont transformé notre abri en une véritable baignoire d’eau glacée qui circule, comme de minuscules petits ruisseaux, sur le fond étanche.
Tant bien que mal, je replace les skis qui tiennent le côté au vent et arrime l’extrémité dans le vent à ma pulka. Je dis à Olivier de faire pression sur la pulka avec sa tête et son dos, depuis l’intérieur de la tente, afin que celle-ci ne décolle pas à nouveau, ne déchire la tente et ne retombe sur nos corps allongés à l’intérieur. J’installe avec difficulté le double toit imperméable et fixe les haubans du côté au vent à l’autre pulka, puis rentre dans la tente. Je suis trempé jusqu’aux os. Je tremble. Il ne fait pas froid dehors, mais le vent et l’humidité pénètrent en profondeur nos corps fatigués.
Il est 17h30. Deux heures ont passé depuis que nous avons décidé d’installer la tente. Le vent n’a pas faibli. Mais ca a l’air de tenir. Nous avons un toit. J’allume une cigarette. La buée omniprésente ajoutée à la fumée m’empêche de voir mes pieds au fond du tunnel écrasé de la tente. Nous ne tenons pas assis, mais à moitié allongés sur un coude. Le bruit du vent couvre nos voix. Il nous faut hurler pour s’entendre.
L’attente commence. Le soir commence à tomber. Il faut penser à la suite. Olivier fait une sortie pour récupérer le réchaud, deux rations alimentaires et un matelas en mousse afin de nous isoler autant que possible du sol de la tente détrempé. Il constate les premiers dégâts : l’abside à moitié fixée commence à se déchirer et l’une des pattes de fixation du double toit est définitivement cassée. C’est à mon tour. Je sors récupérer dans la pulka le combustible pour le réchaud et ma pochette étanche contenant, entre autres les cartes et les numéros de téléphone à contacter en cas d’urgence. La nuit approche, si la tente se déchire, nous nous retrouverons en plein vent, trempés, sans solution pour nous protéger, sans possibilité de faire du feu, de manger ou de boire. La table de refroidissement éolien dont je dispose, qui calcule l’effet du vent sur les températures ressenties par le corps ne mentionne pas les températures obtenues pour des vents de 120 km/h. La limite supérieure – un vent d’une vitesse de 90 km/h – indique que pour une température absolue d’environ –10°c – ce qu’il devrait faire approximativement pendant la nuit – la température ressentie par le corps est de –25°. Avec nos tenues détrempées, la situation deviendrait assez problématique.
Il va falloir tenir toute la nuit. Pour l’instant, avec une tente, de la nourriture pour 5 jours, un réchaud et de l’essence en quantité, nous avons le temps de voir venir. Je prends notre position sur le GPS : 64° 51’ 90’’ Nord, 18° 20’ 70’’ Ouest. Nous ne sommes qu’à une cinquantaine de kilomètres de la fin du fjord qui mène à Akureyri. Nous avons progressé à une vitesse folle pendant la journée. J’essaye de faire fonctionner le téléphone NMT, notre unique lien avec l’extérieur. La veille déjà, son fonctionnement nous avait paru étrange : Olivier, pour la premièrefois, avait essayé de passer un appel, mais il n’avait pu établir de connexion et la batterie avaitcoupé à plusieurs reprises. Malgré l’état de charge qui indique qu’il reste environ un tiers d’autonomie, nous savons donc que nous ne disposons que d’un temps de communication relativement bref, en raison d’un dysfonctionnement technique qui nous échappe.
Nous ne savons pas comment la situation va évoluer. Même si la tempête se calme, notre tente aura souffert, notre équipement sera en partie inutilisable, toutes nos affaires détrempées. Appeler Sylvie, notre contact d’urgence à Reykjavik, pour la prévenir, implique le déclenchement des secours, ce qui nous paraît excessif à cet instant. La solution serait de l’appeler pour lui indiquer notre position, puis d’être sûr de pouvoir la rappeler au petit matin pour faire un point sur notre situation. Malheureusement, nous ne pensons pas que la batterie du téléphone nous le permette. La suite des événements le confirmera. C’est donc quitte ou double. Soit nous appelons dès maintenant et les secours seront déclenchés, soit nous n’appelons pas et nous prenons le risque de le faire beaucoup trop tard si la situation devait empirer.
Vers 20 heures, notre décision est prise. J’allume le NMT. Je compose le numéro de Sylvie. Dès que j’entends sa voix à l’autre bout de la ligne, j’énonce rapidement le texte que nous avons préparé avec Olivier :
– Allo ? Ici, Olivier Le Piouff et Guillaume Hintzy. Urgence. Urgence.
– OK, répond une voix couverte par le grésillement du téléphone et le bruit assourdissant du vent qui secoue la tente.
– Nos coordonnées : 64-5…
Le téléphone coupe. Je rappelle.
– J’écoute, répond la voix lointaine.
– Urgence. Nos coordonnées : 64-51-90, 18-20-70.
Je hurle dans le téléphone pour couvrir le bruit du vent. J’entends, au son qu’émet le récepteur, que la qualité d’émission est de très mauvaise qualité. J’essaye à nouveau. C’est occupé. Le deuxième numéro ? Il ne fonctionne pas. Quels effets la tempête a-t-elle sur les transmissions ? J’éteins le téléphone, enlève la batterie, la confie à mon partenaire pour qu’il la réchauffe sous ses vêtements. Nous voulons préserver au maximum le peu d’énergie qu’il nous reste.
Bien entendu, la situation nous fait réaliser l’erreur que nous avons commise avant notre départ. Nous reposons entièrement sur un seul moyen de communication parce que nous avions décidé, il y a quelques semaines, par simple mesure d’économie, de ne pas emmener avec nous une balise Sarsat. Nous ne savons si nous avons été entendus, si notre position a été comprise. Nous ne pouvons pas donner de nouvelles. Encore moins en recevoir.
Il faut se préparer pour une longue nuit. J’allume le réchaud. Olivier extrait deux plats lyophilisés de nos sachets de rations noyés d’eau. Nous faisons fondre de la neige pour obtenir de l’eau chaude pour nos deux Thermos. Il est 22 heures. Olivier est obligé de soutenir la tente du côté au vent. La toile est de plus en plus distendue. Sous la pression du vent, elle lui enveloppe à moitié le corps, pèse sur son cou et sa tête, lui trempe le dos et les membres, comme un gigantesque matelas d’eau qui le plaquerait contre le sol.
J’ai besoin de m’occuper les mains pour m’occuper l’esprit. Je bouge tout le temps. Boire de petites gorgées d’eau chaude. Rallumer le réchaud qui s’éteint sans cesse envahissant la tente de vapeurs d’essence et de fumées noires. Ecoper pour la énième fois, à la lumière de la lampe frontale, la neige fondue ou l’eau de pluie qui ruisselle au fond de la tente. Allumer le téléphone pendant cinq minutes à chaque nouvelle demi-heure au cas où l’on tenterait d’entrer en communication avec nous. Olivier intériorise beaucoup plus. Il reste allongé calmement, grelottant parfois, sans manifester ce besoin impératif qui m’envahit de bouger, de remuer.
| 8 Mars 2004 |
Température ?°c / ? °c
Passé minuit, je commence à avoir froid. Cela fait maintenant presque 10 heures que je baigne littéralement dans de l’eau glacée. Mes pieds dans mes Sorel détrempées sont gelés. Dès que je me déplace d’une fesse sur l’autre, l’eau qui s’est infiltrée dans mon pantalon joue aux vases communicants. Mes jambes et mes pieds sont ankylosés et bougent difficilement. Mes bras sont humides, mes mains, sans gants depuis bien longtemps détrempés, sont blanches et crevassées. Seul mon buste reste à l’abri de l’humidité. Olivier et moi commençons à trembler régulièrement.
Vers 2 heures du matin, le téléphone sonne.
– Allo, allo ?
– …
– Allo ?
 Le téléphone coupe. Je rallume. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois-ci, j’entends distinctement un «Allo» lointain. J’ai à peine le temps de répondre, le téléphone coupe. C’est certain, maintenant ! Une équipe de secours est à notre recherche et essaie d’entrer en communication avec nous. Ils n’ont peut-être pas notre position, mais au moins, ils sont prévenus. Malgré l’indicateur de charge qui affiche toujours une barre digitale sur un maximum de trois, je n’arrive plus à appeler. Le téléphone coupe instantanément. En revanche, il reste connecté à la réception, quelques secondes avant de s’éteindre. A partir de trois heures du matin, dès que le téléphone sonne, Olivier ou moi répondons immédiatement en donnant nos coordonnées. Jamais entièrement, pas assez de temps. Mais la latitude d’abord : 64-51-90. Puis le téléphone coupe. Nous le rallumons. Quand il sonne à nouveau, la longitude : 18-20-70. Je hurle dans le téléphone, essaye plusieurs techniques. Je décompose : 6-4-5-1-9. Puis 1-8-2-0-7. En anglais. En français.
Le téléphone coupe. Je rallume. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois-ci, j’entends distinctement un «Allo» lointain. J’ai à peine le temps de répondre, le téléphone coupe. C’est certain, maintenant ! Une équipe de secours est à notre recherche et essaie d’entrer en communication avec nous. Ils n’ont peut-être pas notre position, mais au moins, ils sont prévenus. Malgré l’indicateur de charge qui affiche toujours une barre digitale sur un maximum de trois, je n’arrive plus à appeler. Le téléphone coupe instantanément. En revanche, il reste connecté à la réception, quelques secondes avant de s’éteindre. A partir de trois heures du matin, dès que le téléphone sonne, Olivier ou moi répondons immédiatement en donnant nos coordonnées. Jamais entièrement, pas assez de temps. Mais la latitude d’abord : 64-51-90. Puis le téléphone coupe. Nous le rallumons. Quand il sonne à nouveau, la longitude : 18-20-70. Je hurle dans le téléphone, essaye plusieurs techniques. Je décompose : 6-4-5-1-9. Puis 1-8-2-0-7. En anglais. En français.
Cinq heures du matin. Mes membres inférieurs durcissent. J’essaye de bouger de temps en temps mes doigts de pied. Je sais que le soleil se lève vers 8 heures 30, 9 heures, mais les premières lueurs du jour apparaissent 2 heures plus tôt. L’attente est longue. Quand le petit matin approche, le téléphone n’a plus sonné depuis un bon bout de temps. Auraient-ils enfin compris notre position ? Ils sont à notre recherche. Pas loin. Patientez…
Le vent ne s’est pas calmé quand apparaissent les premiers rayons du soleil. Une neige fondue balaye encore l’immensité du plateau islandais. La lumière du jour nous permet de réaliser l’état dans lequel se trouve notre abri. Nous sommes trempés. L’eau est omniprésente. Des sacs de nourriture flottent un peu partout ; un paquet de soupe éventré ; un Mars dégoulinant, mon unique paquet de cigarettes décomposé, les filtres d’un côté, le papier à cigarette de l’autre, le tabac qui flotte à la surface. L’eau de notre bain a une couleur grise-orangée, accentuée par la lumière jaune blafarde que jette le petit matin à travers la toile de tente. Un vrai capharnaüm : un masque ici, un couteau là ; un Thermos ; le GPS (heureusement étanche…). Et toutes nos affaires irrémédiablement trempées : gants en grosse laine, en gore-tex, sous-gants, cache-col, bonnets,… Tout flotte dans ce cloaque nauséabond. Heureusement, nous n’avions pas rentré, hier soir, la totalité de notre équipement (duvet, affaires de rechange,…) sous la tente.
Il nous faut agir. Les vêtements sont essorés et empilés dans un coin. La nourriture inutilisable rassemblée dans une des poches intérieures de la tente ; ce qui n’a pas encore trop souffert dans l’autre. Il faut à nouveau écoper à l’aide d’un quart. Nous avons décidé d’aller chercher dans nos pulkas, à tour de rôle, notre duvet, des sous-vêtements secs, de nouvelles rations alimentaires. Je sors en premier. Le temps est mauvais. J’ai le visage fouetté par la neige, le vent. Un brouillard gris-marron flotte tout autour. J’ouvre ma pulka, puis mon grand sac en Néoprène dont j’espère qu’il a été suffisamment étanche au cours de la nuit. Il y a de l’eau au fond du sac ! Je touche mon duvet. Il est imbibé de flotte. Inutilisable. Tout ce que contient ce maudit sac est totalement inutilisable. Je fais le tour de la tente en courant.
– J’ai plus rien.
– Comment ça ?
– Tout est trempé. Y a 10 centimètres de flotte dans ce putain de sac. Rien de récupérable.
J’ai le moral dans les chaussettes. Je comptais sur mes affaires de rechange pour me sécher et me réchauffer un petit peu ; sur mon sac de couchage pour me reposer. Rien. Plus rien. Mais pourquoi, hier soir, comme tous les autres soirs, comme j’ai appris à le faire depuis des lustres, je n’ai pas retourné ma pulka pour la mettre à l’abri des intempéries ? Pour éviter qu’elle ne se transforme en baignoire ? Je suis fou de rage. Olivier non plus n’a pas retourné sa pulka.
– Alors ?
– Quelques rations alimentaires en bon état, mais surtout mon sac de couchage et ma couverture polaire, énonce-t-il en balançant le tout par la porte entrouverte de la tente.
 « Le reste, irrécupérable », me dit-il, pas beaucoup plus réjoui que moi, lorsqu’il engouffre son corps dans la tente. Nous nous organisons. Il nous faut encore ressortir pour redresser la tente qui s’est complètement affaissée pendant la nuit, sous les coups de boutoir de la tempête et le poids de la neige accumulée sur le côté au vent. Comme à chacune de nos sorties, l’humidité de nos vêtements et le vent violent abaissent fortement la température ressentie à l’extérieur. Nous prévoyons donc chacun de nos gestes dans le moindre détail. Chacun sait ce qu’il a à faire. Il faut aller vite et sans pouvoir se parler. Nos voix sont couvertes par les hurlements des rafales et le bruit du vent qui cogne sur la tente ou s’engouffre dans nos vêtements. Je décide de sortir sans gants. J’évolue dans une humidité générale depuis plus de quinze heures ; l’idée même de remettre mes gants détrempés sur mes mains que j’arrive à peine à réchauffer, me décourage. Je sors. Je sens que la température a du chuter légèrement. Il faut aller vite, mais déjà mes doigts bougent avec difficulté, fouettés, maltraités par un grésil fin qui frappe violemment toutes les parties à nu de mon corps. Mes mains se refroidissent à une vitesse fulgurante. Je sens la douleur monter. Je ne peux pas continuer à aider Olivier. Je me précipite dans la tente pour enfiler mes gants en laine. Même mouillées, au moins mes mains seront à l’abri du vent. Sans cette protection, le la morsure du au vent sur la peau à nu est difficilement supportable.
« Le reste, irrécupérable », me dit-il, pas beaucoup plus réjoui que moi, lorsqu’il engouffre son corps dans la tente. Nous nous organisons. Il nous faut encore ressortir pour redresser la tente qui s’est complètement affaissée pendant la nuit, sous les coups de boutoir de la tempête et le poids de la neige accumulée sur le côté au vent. Comme à chacune de nos sorties, l’humidité de nos vêtements et le vent violent abaissent fortement la température ressentie à l’extérieur. Nous prévoyons donc chacun de nos gestes dans le moindre détail. Chacun sait ce qu’il a à faire. Il faut aller vite et sans pouvoir se parler. Nos voix sont couvertes par les hurlements des rafales et le bruit du vent qui cogne sur la tente ou s’engouffre dans nos vêtements. Je décide de sortir sans gants. J’évolue dans une humidité générale depuis plus de quinze heures ; l’idée même de remettre mes gants détrempés sur mes mains que j’arrive à peine à réchauffer, me décourage. Je sors. Je sens que la température a du chuter légèrement. Il faut aller vite, mais déjà mes doigts bougent avec difficulté, fouettés, maltraités par un grésil fin qui frappe violemment toutes les parties à nu de mon corps. Mes mains se refroidissent à une vitesse fulgurante. Je sens la douleur monter. Je ne peux pas continuer à aider Olivier. Je me précipite dans la tente pour enfiler mes gants en laine. Même mouillées, au moins mes mains seront à l’abri du vent. Sans cette protection, le la morsure du au vent sur la peau à nu est difficilement supportable.
Avec un seul sac de couchage, nous décidons de nous réchauffer par roulements. Olivier se reposera au chaud de 11 heures à 14 heures et moi de 14 heures à 17 heures. Cette journée sera finalement beaucoup plus dure que la nuit précédente ou celle qui suivra. Les heures passent lentement ; l’arrivée du jour n’a amené aucun répit : nous sommes toujours là, le vent gronde, la neige et le grésil balaient le ciel.
Le téléphone a sonné, à nouveau, dans la matinée. Nous avons compris qu’ils ne connaissaient toujours pas notre position. Et j’ai recommencé : 64-51-90, 18-20-70. Pendant des heures…
L’inactivité me pèse. Cette journée maussade n’en finit pas. J’essaye de m’occuper pendant qu’Olivier tente de trouver le sommeil. Nous pensons. Chacun pour soi. Avec pudeur. A nos familles en France qui ont du être prévenues. Que pensent-ils ? Que font-ils ? Nous savons que notre état est loin d’être désespéré. Mais eux ? On a du leur dire que nous avions appelé, que des secours étaient à notre recherche, mais qu’ils ne connaissaient pas notre position et que la zone de recherche était extrêmement vaste. On a du également leur dire que si on ne pouvait nous localiser, du moins on savait que nous étions vivants parce que nous répondions à leurs appels téléphoniques. Combien de temps encore ? Personne ne sait rien de notre situation. Je pense à mes vacances futures. La prochaine fois, promis, le soleil, une plage de sable blanc. Surtout pas d’emmerdes.
Vers 14 heures, nous interchangeons. Olivier prend ma place dans la couverture polaire. Moi dans son sac de couchage. Merci, amigo, parce que tu vas te les cailler ! Même humide, le sac conserve un pouvoir calorifique important. Je me détends peu à peu. Au bout d’environ deux heures, il me semble avoir retrouvé une bonne partie de mes sensations dans mes membres inférieurs. Je jette un coup d’oeil à Olivier. Il est recroquevillé tout au fond du drap polaire. Une fine couche de givre s’est déposée sur la couverture. La température baisse de plus en plus. Pas bon pour cette nuit. Il ne bouge pas, mais je sens bien qu’il ne dort pas. Comme moi.
Je m’évade à nouveau. Combien de temps allons-nous attendre ? Plus de 24 heures ont passé depuis que nous avons monté la tente pour nous abriter. Je commence à sérieusement penser qu’ils ne vont jamais nous trouver.
Il est environ 17 heures. Olivier est frigorifié. Moi, je n’ai aucune envie de quitter la chaleur réconfortante du sac de couchage. Aucun de nous deux n’a vraiment envie de repasser la même nuit que la veille. S’étendre à tour de rôle, jusqu’au lendemain, dans le sac de couchage, ne nous enchante guère. De toutes façons, il ne faut pas rêver nous ne dormirons pas. Il faut continuer à soutenir la tente qui s’effondre du côté au vent. Aors autant se réchauffer au maximum. Nous décidons d’essayer de nous allonger ensemble dans le sac de couchage. Une sacrée expérience que de passer une nuit à deux dans un duvet d’expédition taillé en forme de sarcophage ! Nous faisons une première tentative. Olivier met une bonne dizaine de minutes à se glisser dans le sac dans lequel je suis déjà. Nous sommes complètement compressés, les bras et la moitié du buste à l’extérieur parce qu’ils ne rentrent pas.
Impossible de bouger ou tout va péter !
Le téléphone n’a pas sonné depuis plusieurs heures, quand il sonne à nouveau vers 18 heures. Ils ne savent toujours pas où nous sommes. Ils cherchent. Un dernier coup au moral. Je suis sûr maintenant qu’ils ne nous trouveront pas. Je n’ai qu’une idée en tête : il faut dégager ! Vite ! Nous tombons d’accord. Demain, au petit matin, nous partons. Les sauveteurs ne connaissent pas notre position. Ils cherchent donc au hasard dans un périmètre qui doit être extrêmement large. Que nous soyons ici ou 10 kilomètres plus au sud, au nord, à l’est ou à l’ouest, ne changera rien. Aucune raison d’appliquer à la lettre la consigne habituelle qui consiste à ne pas bouger quand les secours ont été déclenchés. Nous savons que nous sommes à une cinquantaine de kilomètres du début du fjord qui mène à Akureyri. Si nous y parvenons, nous ne serons plus qu’à 40 kilomètres d’Akureyri et nous dominerons toute la vallée encaissée au bout de laquelle se trouve notre ville de départ. Nous savons à peu près certainement – Olivier ayant fait le test le premier soir de notre expédition – que nos portables GSM devraient capter depuis cette zone. C’est le seul moyen de nous en sortir. Il faut que nous partions demain matin, au lever du jour, et que nous abattions le plus rapidement possible, dans le vent et la neige, les 50 kilomètres qui nous séparent de cette zone. Impossible de tout faire en une journée. Au mieux, une journée, plus toute une nuit. En abandonnant tout ici, sauf la tente, le réchaud, un peu de nourriture et quelques litres d’essence, nous pouvons avancer rapidement. Peut-être 3 ou 4 kilomètres à l’heure, compte tenu de notre fatigue et des conditions. Avec les quelques courtes pauses nécessaires, il faut compter moins d’une vingtaine d’heures. Si nous sommes exténués, nous monterons à nouveau la tente, pour une dernière nuit de bivouac et nous repartirons le lendemain pour réaliser les derniers kilomètres. Si à cause du froid ou du vent, nous ne parvenons à skier qu’une dizaine d’heures par jour, nous serons de toutes façons dans deux jours, à peu près à la même heure, au début de ce satané fjord. Arrivé là-bas, il faudra – pour une fois – que la technologie ne nous abandonne pas. Il faudra que ça marche… Je m’apprête donc demain à laisser ici une partie de mon matériel : mon sac de couchage imbibé d’eau, mes affaires de rechange détrempées,… Tout ca n’a plus aucune utilité.
Cette décision me réconforte. Enfin de l’action. L’inactivité me pesait. Maintenant il suffit de boire chaud, d’essayer de se réchauffer et de se reposer au mieux pour le lendemain. Il faut rester en alerte. Dans quel état serons-nous demain au moment de partir ? Après deux nuits blanches passées dans le froid et l’humidité à grelotter ? Dans quel état serons-nous, après-demain matin, quand il s’agira de s’élancer pour la dernière partie du chemin, après 72 heures sans sommeil, avec un minimum de nourriture ? J’appréhende le vent. Il faut absolument qu’il baisse. Demain, nous partirons en remettant nos Gore-tex détrempées. Si le vent souffle encore fort, nous allons être transis en quelques minutes. Il faudra avancer vite. Vite. Ce que je redoute, c’est une baisse de température. Si elle chute à –10°c ou –15°c, tout va devenir beaucoup plus compliqué. Avec notre équipement trempé, nous serons particulièrement vulnérables à la moindre chute de température. Tout gèlera très rapidement. Et la tente ? Qui résiste tant bien que mal, mais qui part en lambeaux. Est-ce qu’elle tiendra une dernière nuit ? Résistera-t-elle à un pliage, puis à un nouveau montage dans le vent. On va passer c’est sûr, mais il ne faudrait pas que tout se ligue contre nous. Dans ces régions, tout se joue à très peu de choses. Si demain, le vent est tombé, le soleil tape, le ciel est sans nuages, tout s’arrangera. Nous ferons sécher notre équipement au soleil et nous serons totalement sortis d’affaire. Tout peut facilement basculer d’un côté comme de l’autre, entraînant une infinité de complications et de conséquences.
La nuit est tombée. Vers 23 heures, notre téléphone rend définitivement l’âme. Ca y est : nous n’avons plus aucun moyen de communication. L’écran ne s’allume plus. Nous sommes coupés du monde. Nous ne les entendrons plus ; ils ne nous entendront plus. Nous avons pris la bonne décision : ils ne nous trouveront pas. J’en suis persuadé. Il faut partir. Vers le nord, vite.
La nuit s’installe, et avec elle, le froid. Il faut se contorsionner dans tous les sens pour arriver à s’installer, tous les deux, dans le sac de couchage.
| 9 Mars 2004 |
Température ?°c / ? °c
Minuit. Tout est plus calme. Je ne pense à rien. Nous parlons peu.
Trois heures du matin. J’ai l’impression que le vent tombe de plus en plus. Par moments, quelques rafales, mais rien d’aussi soutenu que les heures précédentes.
 Quatre heures du matin. La tente se secoue mollement. Par moments, elle tressaille encore, mais le vent dehors ne doit pas souffler à plus de 30 km/h. Par intermittence, j’allume ma lampe frontale pour que la tente puisse être visible de l’extérieur. Un petit point rond, tout jaune, dans la nuit. Qui sait ?
Quatre heures du matin. La tente se secoue mollement. Par moments, elle tressaille encore, mais le vent dehors ne doit pas souffler à plus de 30 km/h. Par intermittence, j’allume ma lampe frontale pour que la tente puisse être visible de l’extérieur. Un petit point rond, tout jaune, dans la nuit. Qui sait ?
Six heures. J’ai du m’assoupir un moment. Je n’en crois pas mes oreilles. Ca cogne dehors. Ce putain de vent repart de plus belle. Mon compagnon bouge.
– Guillaume, t’entends ?
– Ca fait chier…
L’heure du lever est programmée à sept heures pour éviter au maximum le froid des premières heures du jour. Le vent souffle fort dehors ; la tente est balancée de droite à gauche. Combien 70, 80 km/h ? J’en ai marre. Marre de ce drapeau, dans ma tête, qui claque au vent sans cesse, faisant un boucan de tous les diables.
Vite. Vite. Partir maintenant. On ne fera pas 50 kilomètres dans ces conditions. Il faudra le faire en deux jours. Déjà 20 ou 25 kilomètres avec ce vent… Alors partir maintenant ?
Nous décidons d’attendre une heure. On ne sait jamais, ca va peut-être se calmer. Aucun de nous deux n’a envie d’y aller. Dehors, tout est hostile. J’abaisse la fermeture éclair de la porte : pas de visibilité, un temps gris, maussade. Le vent souffle au raz du sol emportant, en rafales, une neige sale qui enveloppe d’un manteau gris le haut plateau. A 8 heures, nous partirons. Quelles que soient les conditions.
Quelques dizaines de minutes encore. Le vent qui gronde fait tant de bruits différents, des bruits de sifflement, des bruits sourds, des bruits répétitifs. Celui-ci entêtant ; celui-la…Non… Non, cette fois, c’est mécanique !
– Oliv, c’est une motoneige !
– …
– T’entends, bordel ? !
Un phare s’est posé sur la toile de tente. J’essaye de me dresser sur un coude.
– Are you the French team ?, hurle une voix à l’extérieur.
– Yes, yes ! !
Des pas. La tente est secouée. La porte s’ouvre, le vent s’engouffre, puis un casque apparaît dans l’ouverture.
– Thank you, thank you !
J’ai rarement été aussi heureux.
– Are you OK ?
– Yes !
Le casque se retire. Je l’entends marcher dans la neige. Une radio crépite.
– Yeaaahhh ! !
Il parle rapidement en islandais. Il exulte. Il doit leur expliquer que nous sommes sains et saufs.
Je suis bien. Tout est fini. Je passe ma main sur l’épaule d’Olivier et la serre.
Ouais… ce matin, on n’avait vraiment pas envie d’y aller
| Epilogue |
Plusieurs moto neiges sont arrivées les unes après les autres. Les équipes de secours nous ont apportés de la nourriture, de l’eau et des affaires propres et chaudes. Nous avons attendu une heure sous la tente, puis nous avons été transférés dans une chenillette. Nous avons mis 11 heures à rejoindre la ville de Hella sur la côte sud. L’état du terrain était lamentable. La débâcle était totale. De l’eau partout, des rivières en crue, des lacs dégelés. A de multiples endroits, la neige avait quasiment disparu. Dans ces conditions, il aurait été extrêmement difficile de progresser vers le nord, ou tout simplement de tirer notre pulka.
 Nos sauveteurs nous ont expliqué que les recherches étaient suivies par les media locaux depuis deux jours : presse, télévision, radio, tout y est passé. Sur le chemin du retour, le grand journal islandais, le Morgunbladid, une première fois, puis le 20 heures d’une chaîne de télévision nationale, une deuxième fois, nous interviewèrent par téléphone satellite. A l’arrivée à Hella, deux photographes étaient présents pour illustrer les articles à paraître le lendemain.
Nos sauveteurs nous ont expliqué que les recherches étaient suivies par les media locaux depuis deux jours : presse, télévision, radio, tout y est passé. Sur le chemin du retour, le grand journal islandais, le Morgunbladid, une première fois, puis le 20 heures d’une chaîne de télévision nationale, une deuxième fois, nous interviewèrent par téléphone satellite. A l’arrivée à Hella, deux photographes étaient présents pour illustrer les articles à paraître le lendemain.
Après un détour par le poste de Police, nous avons rejoint un petit hôtel dans lequel les autorités locales nous ont logé. Nous nous sommes couchés vers une heure du matin. Nous n’avions pas fermé l’oeil depuis plus de 60 heures.
Notre position n’a jamais été comprise. Seuls les deux premiers chiffres de latitude et longitude (64° et 18°) avaient été correctement captés. Les recherches ont donc été engagées sur une zone d’environ 100 kilomètres par 100, soit 10 000 kilomètres carrés. En raison des conditions météorologiques et du terrain déplorables, les secours ont mis 20 heures à parvenir dans la zone de recherche. Ils étaient constitués de quatre équipes issues de quatre villes différentes, deux situées sur la côte nord, deux sur la côte sud.
En tout, une quarantaine de personnes était mobilisée à notre recherche ; une dizaine de motoneiges, une chenillette, un camion amphibie, cinq superjeep, des camions.
Les secours ont pu affiner la zone de recherche grâce aux appels passés sur notre téléphone. La veille de notre récupération, une équipe est passée, en motoneige, à 800 mètres de notre tente, sans l’apercevoir. Bien que tous les membres des équipes de secours aient été bénévoles, le coût des recherches s’est élevé à plusieurs dizaines de milliers d’euros – heureusement pris en charge par nos assurances – en raison des nombreuses casses de matériel.
L’entente avec mon compagnon de galère fut merveilleuse. C’est, sans aucun doute, mon meilleur souvenir.
Il y en a un autre qui restera impérissable, celui de notre plus grosse erreur : s’être entièrement reposé sur un seul moyen de communication et ne pas avoir doublé les sécurités, en emportant dans nos bagages une balise Sarsat
Remerciements
Aux membres des équipes de recherches et de secours des localités de Akureyri, Dalvik, Hella et Hvolsvelli, qui ont travaillé, sans relâche, dans des conditions exécrables pour nous retrouver.
A Sylvie Primel, notre contact en Islande, qui s’est dépensée sans compter pour assurer le lien avec les équipes de sauvetage et les autorités islandaises.
A Grand Nord Grand Large, pour leur professionnalisme, leur disponibilité et les précieux conseils qu’ils nous ont apportés.
Aux Islandais et Islandaises, qui se sont toujours montrés disponibles et accueillants, avant et après notre équipée.
TECHNICAL SHEET
Description : Crossing of Iceland from north to south
Country : Iceland
Duration : 11 days (March 2004)
Place of departure : Akureyri (65°N 18°O)
Altitude : n/a
Place : Islande
Arrival point : failure at 64°N 18°O (weather)
Means of transport : ski
Others : unsupported
Team : Guillaume Hintzy, Olivier Le Piouff
PARTNERS